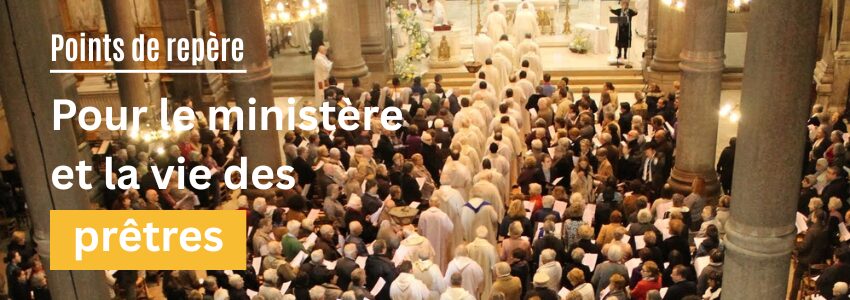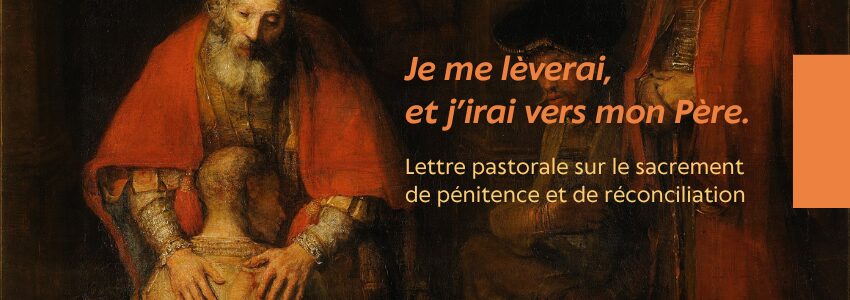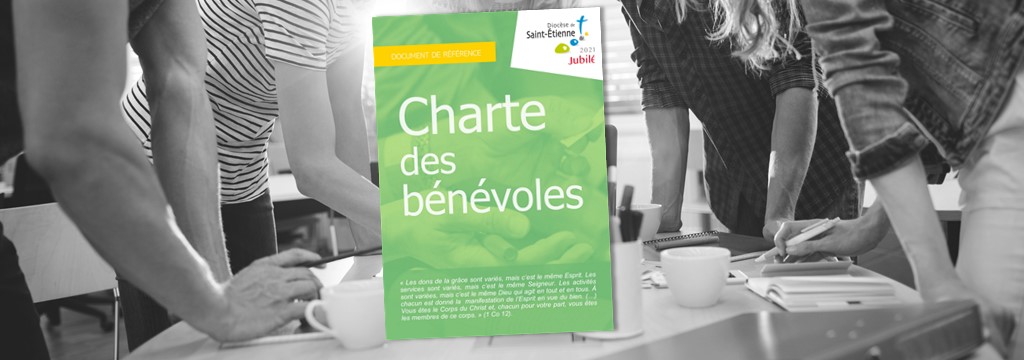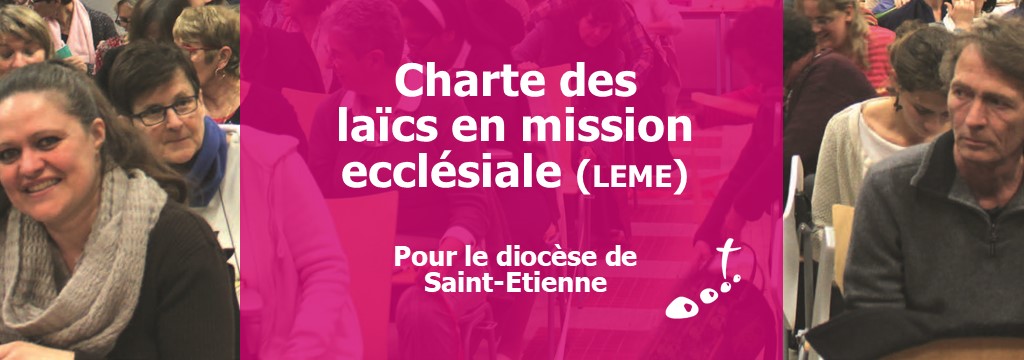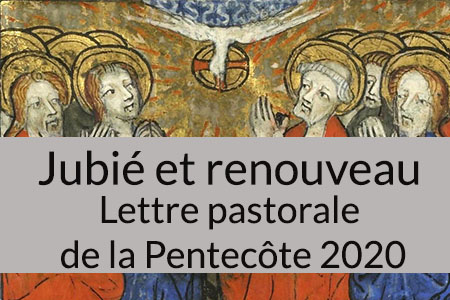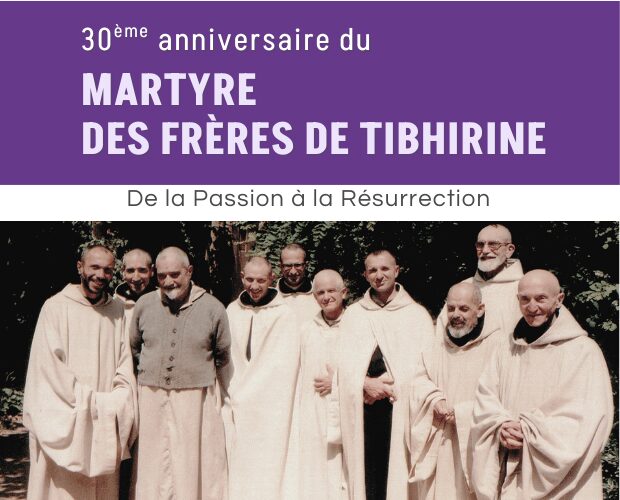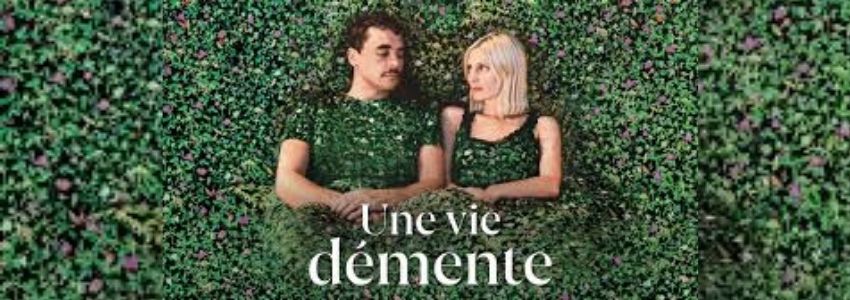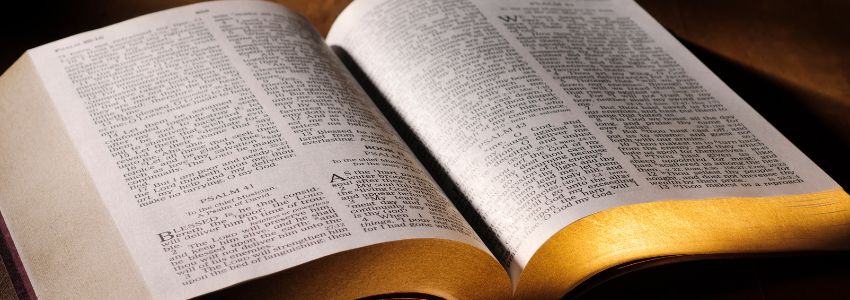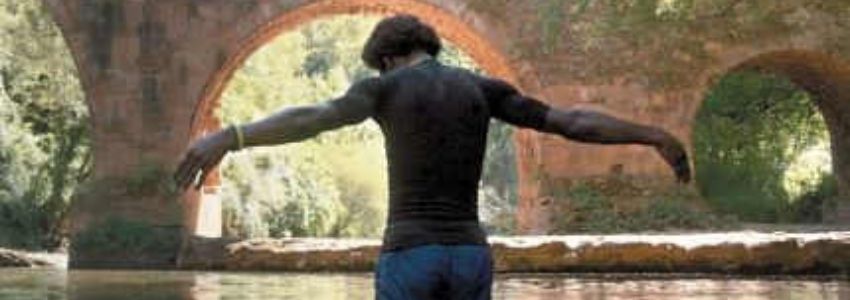Télécharger les points de repère au format PDF
Prêtres aujourd’hui
Dans le contexte d’une société en grande mutation, devenue aussi largement multiculturelle, notre Église vit, elle aussi, de profondes transformations et plus encore un appel au renouveau évangélique et missionnaire. Ces évolutions nous conduisent à expérimenter d’une manière toute particulière le mystère pascal auquel le Christ associe son Église. C’est un mystère de mort et de résurrection, avec la fin d’une forme de présence de l’Église dans la société, mais aussi un renouveau spirituel. C’est aussi un mystère de communion, dans une juste collaboration de tous les fidèles laïcs et ministres ordonnés, au service de la mission de l’Église, de la nouvelle évangélisation promue par le Concile Vatican II.
L a transformation pastorale en cours, stimulée par l’arrivée de nombreux catéchumènes ces dernières années, ne pourra porter tous ses fruits que dans la mesure où chacun déploie sa vocation et accueille pleinement celle des autres, pour agir en synodalité. Dans notre diocèse, plusieurs points de repère ont été publiés pour le ministère et la vie des diacres, pour les Laïcs En Mission Ecclésiale, pour l’engagement bénévole. Il était donc cohérent de disposer aussi d’un document concernant les prêtres. Des textes fondamentaux balisent le chemin : Presbyterorum Ordinis du Concile Vatican II, Pastores Dabo Vobis de S. Jean-Paul II, le Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, de nombreuses interventions de papes sur le sujet… Il s’agit donc ici de rappeler simplement quelques éléments essentiels de ce ministère et surtout d’indiquer la manière dont nous essayons de le vivre dans le diocèse de Saint-Étienne.
Ce document s’adresse d’abord aux membres de notre presbyterium, et tout spécialement aux prêtres qui le rejoignent. Il pourra aussi être éclairant pour les diacres et tous ceux qui collaborent avec les prêtres, ainsi que pour des jeunes qui perçoivent un appel à devenir prêtre. Souhaitons que ces quelques points de repère puissent aider les pasteurs à vivre pleinement leur précieux ministère et encourager un renouveau vocationnel.
Chapitre 1 – Identité et mission des prêtres

Dans le Nouveau Testament
Dans l’Évangile, nous voyons Jésus appeler ses Apôtres, pour « qu’ils soient avec lui et les envoyer annoncer la Bonne Nouvelle » (Mc 3, 14). Au cours de la dernière Cène, il les invite à renouveler, « en mémoire de lui », ce repas pascal dans lequel il se donne tout entier. Ressuscité, il leur dit : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 18-20)
Enfin le jour de la Pentecôte, « tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit » (Ac 2, 4) pour proclamer les merveilles de Dieu. Ils partent alors en mission et reçoivent de nombreux collaborateurs, à commencer par Paul, mais aussi des presbytres (anciens), des diacres et d’autres « disciples-missionnaires », hommes et femmes. Au fil du temps, les communautés se structurent et les ministères se précisent. Ils évoluent selon les nécessités de la mission.
Prêtres selon le Concile Vatican II
Successeurs des Apôtres, les évêques accomplissent la mission de l’Église avec les prêtres, les diacres, les religieux et l’ensemble des fidèles laïcs. Les prêtres sont les « coopérateurs de l’Ordre épiscopal dans l’accomplissement de la mission apostolique confiée par le Christ. (…) Ils participent à l’autorité par laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son Corps. » (PO 2) « En vertu du sacrement de l’Ordre, à l’image du Christ-prêtre, suprême et éternel, ils sont consacrés pour prêcher l’Évangile, pour être les pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament. » (LG 28)
« Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des frères parmi leurs frères, membres de l’unique Corps du Christ dont l’édification a été confiée à tous. (…) En unissant leurs efforts à ceux des fidèles laïcs, et en se conduisant au milieu d’eux à la manière du Maître : parmi les hommes, celui-ci « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » (Mt 20, 28) Les prêtres ont à reconnaître sincèrement et à promouvoir la dignité des laïcs et leur rôle propre dans la mission de l’Église. Ils doivent respecter loyalement la juste liberté à laquelle tous ont droit dans la cité terrestre. » (PO 9)
En réponse à l’appel
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis » dit Jésus à ses Apôtres (Jn 15, 16). « L’histoire de toute vocation sacerdotale, comme d’ailleurs de toute vocation chrétienne, est l’histoire d’un ineffable dialogue entre Dieu et l’homme, entre l’amour de Dieu qui appelle et la liberté de l’homme qui, dans l’amour, répond à Dieu. (…) Dans la vocation, brillent ensemble l’amour gratuit de Dieu et l’exaltation la plus haute possible de la liberté humaine, celle de l’adhésion à l’appel de Dieu et de la confiance en lui. (…) L’offrande libre, qui constitue le noyau le plus intime de la réponse de l’homme à Dieu qui appelle, trouve son modèle incomparable, mieux, sa racine vive, dans l’offrande très libre de Jésus-Christ, le premier des appelés, à la volonté du Père : « C’est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit : « Tu n’as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m’as façonné un corps… Alors j’ai dit : Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » (He 10, 5-7) » (Jean-Paul II, Pastores Dabo Vobis 36)
Consacrés pour la mission
Vivant au milieu des hommes, le prêtre est « mis à part pour l’Évangile de Dieu » (Rm 1, 1). Cette consécration donne une dimension particulière à sa présence au milieu de la communauté humaine et du peuple de Dieu. Sa manière de vivre les conseils évangéliques est une dimension de sa mission prophétique qui contribue à faire grandir dans la charité ceux qui lui sont confiés. C’est en se laissant convertir chaque jour qu’il peut avancer sur cette voie.
En réponse à l’appel du Christ qui invite à tout quitter pour le Royaume, le célibat est signe de cette consécration particulière. Reçu comme un don, sa signification est spirituelle et pas simplement matérielle. Il veut traduire d’une manière très concrète les paroles de l’Eucharistie et l’offrande du Christ sur la Croix : « Ceci est mon corps livré pour vous ». Notre époque interroge plus particulièrement cet état de vie qui paraît peu compréhensible. Pour être vécu pleinement, dans la durée, le célibat consacré demande un équilibre qui intègre toutes les dimensions de l’humanité du prêtre : corps, affectivité et psychologie, intelligence et volonté, relation à Dieu et aux autres… À la suite du Christ qui s’est donné au genre humain, le célibat est pauvreté et disponibilité pour Dieu et pour la mission.
Cette pauvreté est aussi à vivre sur le plan matériel. Quand le Christ appelle ses apôtres, il leur demande de tout quitter pour le suivre. Au jeune homme riche, il dit « va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » (Mc 10, 21) Le Concile Vatican II invite les prêtres « à embrasser la pauvreté volontaire qui rendra plus évidente leur ressemblance avec le Christ et les fera plus disponibles au saint ministère. Le Christ s’est fait pauvre pour nous, lui qui était riche, afin de nous enrichir par sa pauvreté. Les Apôtres, à leur tour, ont montré par leur exemple qu’il faut donner gratuitement ce que Dieu accorde gratuitement. » (Presbyterorum Ordinis 17), cf Annexe : Conditions de vie matérielle des prêtres

Chapitre 2 – Quelle mission pour les pasteurs aujourd’hui ?

Pour une transformation missionnaire
« Pour être un bon guide de son peuple, le prêtre sera attentif à reconnaître les signes des temps : ceux qui touchent l’Église universelle et son cheminement dans l’histoire des hommes jusqu’aux signes les plus proches de la situation concrète de sa communauté. » (Directoire pour le ministère et la vie des prêtres n° 78) Parmi les signes les plus importants, nous observons en même temps la fin d’une forme de fonctionnement paroissial et l’arrivée de nouveaux croyants aspirant à une vie chrétienne forte, spirituelle, fraternelle et missionnaire. Le Pape François nous interpelle : « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. » (Joie de l’Évangile n° 27)
Les prêtres sont appelés à développer, avec les diacres et les laïcs en mission, une approche pastorale renouvelée qui donne à chacun sa place dans une authentique fraternité et conduit tous les baptisés à devenir des disciples-missionnaires, pour que l’Église tout entière évangélise.
Serviteurs de la Parole de Dieu
« Les prêtres, comme coopérateurs des évêques, ont pour première fonction d’annoncer l’Évangile de Dieu à tous les hommes. » (PO 4)
Le prêtre est un homme d’Évangile. Toute sa vie est imprégnée par la fréquentation de la Parole de Dieu. Il ne se contente pas de la proclamer, mais il en vit. Il prend le temps de l’étudier, de la méditer pour en tirer une intelligence savoureuse et fidèle à la Tradition de l’Église. L’annonce de cette Parole est au cœur de sa mission, par la prédication, la catéchèse et son témoignage de vie.
Le prêtre veille à donner le goût de la Parole à tous ceux qui collaborent avec lui, dans les groupes de catéchèse, les équipes de préparation aux sacrements, les équipes liturgiques et les divers mouvements. Les partages d’Évangile entre prêtres, ou avec des laïcs, sont des sources de renouvellement et d’émerveillement.
Ministres des sacrements et des sacramentaux
Hommes de prière et d’intériorité, les prêtres sont au service de la mission de sanctification du peuple de Dieu par la célébration des sacrements. L’Eucharistie, source et sommet de la vie de l’Église, est au cœur de la vie spirituelle des prêtres. Ils rassemblent la communauté autour du Christ pour que tous accueillent le don de sa vie et s’offrent « par Lui, avec Lui et en Lui ». Ils célèbrent l’Eucharistie avec et pour le peuple qui leur est confié. Ils favorisent une authentique participation de tous, active et fructueuse, et ils veillent à ouvrir au mystère de Dieu, si proche et si transcendant. Ils sont attentifs à mettre en valeur la diversité et la richesse des temps et fêtes liturgiques.
Ministres de la réconciliation, témoins de la miséricorde de Dieu, les prêtres se rendent disponibles pour ceux qui souhaitent recevoir le pardon. En plus de la confession individuelle, des célébrations pénitentielles font précéder l’absolution individuelle d’une démarche qui signifie la dimension communautaire de la conversion.
Avec les diacres, les prêtres célèbrent les sacrements de baptême et de mariage. Avec les équipes paroissiales ou en alliances, ils veillent à offrir à chacun un temps de préparation, d’approfondissement de la foi, en vue d’une célébration féconde des sacrements. Cette préparation est souvent l’occasion d’une première annonce auprès des personnes qui sont plus loin de la foi.
Par le sacrement de l’onction des malades, le prêtre signifie la proximité salvifique de Jésus auprès de ses frères et sœurs souffrants ou âgés.
Les funérailles sont aussi l’occasion de célébrations importantes où l’Église accueille ceux qui sont touchés par le décès d’un proche ainsi que ceux qui viennent les entourer. Ce sont des moments où les questions fondamentales peuvent se poser en vérité. Des équipes sont présentes et actives dans les paroisses. Pour autant, la présence d’un prêtre est importante, selon ses possibilités et les circonstances. Ce sont pour lui de précieuses occasions de contacts avec des personnes et des familles plus éloignées de l’Église. Les rencontres qui précèdent sont des moments favorables d’évangélisation.
Enfin, le prêtre est celui qui bénit largement les personnes au nom du Seigneur et, le cas échéant, leurs activités et tout ce qui contribue à leur bien et à celui du monde.
Autorité et synodalité
Le prêtre est envoyé à une communauté, pour en être le pasteur au nom du Christ bon Pasteur. Dans sa responsabilité de gouvernement, il est particulièrement chargé de la communion entre tous et de la mission, afin que la communauté soit évangélisatrice et toujours ouverte à ceux qui souhaitent la rejoindre. Il accomplit cette mission en collaboration avec les fidèles engagés, en veillant à la subsidiarité et à la synodalité.
« L’Esprit Saint, non seulement sanctifie et conduit le Peuple de Dieu par les sacrements et les ministères et l’orne des vertus, mais « répartissant ses dons à chacun comme il veut », il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres des grâces spéciales, qui rendent apte et disponible à assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l’Église. » (Lumen Gentium 12)
Pasteur au sein d’une communauté de baptisés appelés à devenir disciples-missionnaires, le prêtre discerne et favorise l’exercice des charismes. Il s’appuie sur les dons et les initiatives que l’Esprit suscite au sein du Peuple de Dieu pour répondre au mandat missionnaire du Christ. Il favorise l’écoute, le dialogue et le discernement communautaire, afin que les charismes de chacun s’inscrivent dans la mission et la communion de l’Église. Parmi les joies du ministère, il y a celle d’appeler des personnes, de les voir se mettre en route et déployer leurs charismes au service de la mission.
L’autorité du prêtre sera vécue de façon authentique si le pasteur s’efforce lui-même de vivre la vertu d’obéissance. Il s’agit d’obéir à l’Esprit, à travers l’écoute de sa conscience, l’accueil de ce qu’il reçoit de l’Église et de son évêque, et l’ouverture à ce que portent ses frères et sœurs dans le Christ.
Diaconie
« Les prêtres, certes, se doivent à tous ; cependant ils considèrent que les pauvres et les petits leur sont confiés d’une manière spéciale ; le Seigneur, en effet, a montré qu’il avait lui-même partie liée avec eux, et leur évangélisation est présentée comme un signe de l’œuvre messianique. » (Presbyterorum Ordinis O 6)
Dans la grâce de son ordination diaconale, le prêtre veille à ce que la communauté soit ouverte à tous et qu’elle soit toujours accueillante aux personnes nouvelles, en particulier les plus fragiles et les plus pauvres, en se laissant évangéliser par leur présence et leur témoignage.
Par son attention au cri des pauvres, le prêtre manifeste la dimension prophétique de son ministère. À la lumière de la Parole de Dieu et de la doctrine sociale de l’Église, il a soin d’éveiller les consciences et de soutenir tous ceux qui sont engagés au service des plus fragiles.
Accompagnement des personnes et des groupes
Le prêtre est au service de la vie spirituelle des membres du peuple de Dieu. Il consacre du temps à l’accompagnement individuel de personnes désireuses d’avancer dans la foi et dans leur relation au Christ. Il les aide à approfondir le sens de la prière et la vie selon l’Évangile. Il peut faire connaître les différentes familles spirituelles présentes dans le diocèse. Elles sont une aide précieuse pour un grand nombre de fidèles, ainsi que les divers groupes de prière et lieux de ressourcement spirituel.
Le prêtre écoute. Il aide au discernement. Il apporte un soutien au moment de l’épreuve. Il encourage chaque personne accompagnée sur le chemin de la sainteté. Il lui fait découvrir également les exigences de la mission et comment elle peut prendre sa place dans l’annonce de l’Évangile. Il s’émerveille souvent de voir l’Esprit à l’œuvre dans le cœur des personnes.
En lien avec les personnes engagées dans la Pastorale de la santé, le prêtre est attentif aux malades et aux personnes âgées, pour les visiter, les réconforter et leur offrir le secours des sacrements.
Le ministère du prêtre comporte aussi une dimension d’accompagnement des mouvements (Action catholique, mouvements de spiritualité ou éducatifs). Ce sont habituellement les laïcs qui assument les responsabilités de conduite, mais le prêtre participe en apportant un éclairage biblique et spirituel. Il aide les personnes à prendre du recul, à déployer leur vocation chrétienne dans toutes les dimensions de leur vie.
Œuvrer à l’éducation des jeunes et au service des plus fragiles est une belle tâche. Elle exige un grand respect de chacun et nous en avons davantage conscience depuis que les drames des abus sexuels ont été mis en lumière. Avec toute l’Église, nous sommes résolument engagés dans la prévention et la lutte contre ces abus. Tous les prêtres en ministère dans le diocèse de Saint-Étienne doivent adhérer à une charte qui définit les principes fondamentaux et les bonnes pratiques pour que notre Église soit digne de sa mission reçue du Christ et de la confiance des fidèles. Cette charte engage chacun à participer à l’action de l’Église, et à celle de la société, en faveur de la protection des mineurs et des personnes vulnérables.
Le curé
Le curé est le pasteur propre de la paroisse. Il en a la responsabilité spirituelle, pastorale et administrative. Il partage l’exercice de la mission avec d’autres prêtres, des diacres, des laïcs en mission ecclésiale, tout particulièrement le coordinateur paroissial, et d’autres baptisés, dans la diversité de leurs charismes, de leurs fonctions, de leurs disponibilités. Le curé a une vision globale de la vie paroissiale, il est particulièrement attentif à la communion entre tous et à la subsidiarité, en partageant largement les missions et les responsabilités.
Par sa proximité avec son peuple, par le discernement avec ses collaborateurs (laïcs et ministres ordonnés), par l’écoute de chacun et l’ouverture à l’Esprit Saint, le curé donne un véritable dynamisme à sa paroisse, en lien avec les orientations diocésaines et celles de l’Église universelle.
Les orientations pastorales de la paroisse sont discernées principalement au sein du Conseil Pastoral Paroissial. L’Équipe de Conduite Pastorale, plus restreinte, assure le suivi de leur mise en œuvre.

Chapitre 3 – Les prêtres dans l’Église diocésaine

Dimension diocésaine et incardination
À l’exemple et à la suite du « Christ qui a aimé l’Église et s’est livré pour elle » (Ep 5, 25), le prêtre, intimement lié à l’Église, est tout entier à son service, par le don de lui-même. Au jour de son ordination, le prêtre diocésain s’attache à une Église particulière par l’incardination. C’est un lien juridique, pastoral, spirituel et affectif à un peuple, à une histoire, à un territoire et à son devenir. Les prêtres diocésains assurent à l’Église diocésaine une stabilité sur la durée, une continuité dans l’action pastorale.
Universalité de l’Église, prêtres fidei donum et religieux
Le diocèse accueille aussi des prêtres, séculiers ou religieux, d’autres diocèses, d’associations, d’instituts ou de congrégations. Certains viennent d’autres pays. Ils sont associés, dans la diversité de leurs charismes et de leurs cultures, au service de la mission. Ils ont à la fois à être accueillis comme tels, avec leurs expériences et leurs manières d’être différentes, et à s’insérer dans une histoire humaine et pastorale, une dynamique spirituelle et missionnaire, un contexte culturel.
Les prêtres du diocèse de Saint-Étienne accueillent comme une grâce les prêtres venant d’ailleurs. Ils les aident à s’insérer dans la mission de l’Église et dans le presbyterium, dans un réseau de relations. Cette complémentarité des prêtres incardinés dans le diocèse et des prêtres venus d’autres horizons géographiques ou ecclésiaux s’inscrit dans l’histoire même de la Loire, terre d’accueil qui s’est enrichie de populations nouvelles, tout spécialement ces deux derniers siècles.
Diversité des charismes et des besoins de la mission
La variété des charismes, des tempéraments et des générations conduit à une grande diversité de figures de prêtres. Leur collaboration et leur fraternité sont essentielles à l’accomplissement du ministère presbytéral.
En fonction de leurs charismes et des besoins de la mission, les prêtres sont répartis pour répondre au mieux aux diverses réalités pastorales. Cela demande à chacun, en particulier à l’occasion d’une nouvelle nomination, de connaître, d’aimer et d’adopter le peuple auquel il est envoyé, avec ses grâces et ses limites, pour se donner à lui en vérité. C’est une condition pour la fécondité du ministère.
Envoi en mission et relecture
Chaque prêtre, qu’il soit diocésain ou membre d’une association ou d’une congrégation, se voit habituellement confier une ou plusieurs missions par l’Évêque, selon les besoins pastoraux et les possibilités. Ces nominations sont publiées dans les organes d’information diocésains et les plus importantes font l’objet d’un décret de nomination.
Une relecture de mission est faite régulièrement, au moins tous les trois ans, avec l’Évêque ou le Vicaire général, et tous les ans pour les prêtres plus jeunes.
Les prêtres peuvent également vivre une relecture plus approfondie de leur ministère avec un des prêtres ayant reçu cette charge de l’Évêque et deux ou trois personnes avec qui ils partagent la ou les missions confiées. Cette démarche peut être demandée par le prêtre ou proposée par le Vicaire général. Il est judicieux de vivre une telle relecture un an avant l’échéance d’une mission, afin d’envisager l’avenir.
Presbyterium, rassemblements et temps forts
Le presbyterium est la communion, autour de l’Évêque, de tous les prêtres qui œuvrent sur le territoire du diocèse de Saint-Étienne ou qui y sont incardinés. La fraternité, entre eux et avec tous les baptisés, soutient leur dynamisme missionnaire et favorise leur enracinement dans l’Église diocésaine. Elle se traduit par un soutien mutuel dans la vie et le ministère, notamment par la prière, l’amitié et l’entraide. Les doyennés ont vocation à favoriser ce soutien mutuel.
Plusieurs temps forts réunissent chaque année l’ensemble du presbyterium. La Messe chrismale, au cours de laquelle l’Évêque bénit les saintes huiles, est un moment particulier témoignant de cette communion presbytérale au service du salut en Jésus-Christ. Au cours de cette messe, les prêtres sont invités à renouveler les promesses de leur ordination. La Messe chrismale est précédée d’un temps fraternel d’échanges, de formation et d’information, habituellement avec la participation des diacres et de leurs épouses.
Deux autres temps sont proposés chaque année. D’une part la semaine de retraite spirituelle prêchée qui permet de vivre une communion dans le silence et la prière. D’autre part, en début d’année pastorale, un séjour de trois jours à l’extérieur du diocèse, permettant de vivre un temps fraternel et de découvrir d’autres réalités humaines et ecclésiales. C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec les prêtres nouvellement arrivés dans le diocèse et de les accueillir.
Conseil presbytéral
Le Droit canonique indique : « Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’Évêque. » (CIC 495 §1) Le conseil presbytéral a « ses propres statuts approuvés par l’Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la conférence des Évêques » (cf. CIC 496).
La majorité des membres du conseil presbytéral est élue par l’ensemble du presbyterium. Il y a des membres de droit, et quelques prêtres peuvent être nommés par l’Évêque. Selon ses statuts, le conseil presbytéral élit en son sein un bureau qui apporte son soutien à l’Évêque pour gérer la préparation, l’animation et le suivi des rencontres.
Parmi les membres du conseil presbytéral, l’Évêque désigne les membres du collège des consulteurs pour une durée de cinq ans (CIC 502), lequel est sollicité pour les questions administratives et économiques de grande importance, et en cas de vacance du siège épiscopal.
Chapitre 4 – Unité et équilibre de vie des prêtres

L’unité de la personne
La multiplicité des sollicitations et des charges peut entraîner une forme de dispersion des prêtres dans leur vie et leur ministère. Quelles priorités se donner ? Vivre toutes ses activités, en cherchant à les unifier dans un sens spirituel et pastoral, est pour le prêtre un enjeu de taille. Face à l’urgence de la mission, il s’agit de trouver un juste équilibre mais aussi de consentir à une dépossession, dans un abandon à Dieu qui seul conduit toute chose.
Le prêtre doit donc rechercher l’unité intérieure et cet équilibre de vie. Il est attentif à toutes les dimensions de son être. Sa santé est un bien précieux. Elle demande du sommeil, une nourriture équilibrée, de la détente, de l’activité physique, de la lecture, des temps de repos… dans une certaine sobriété.
Choisir la radicalité évangélique tout en acceptant ses propres limites est un chemin de crête pour tous les disciples du Christ. Ensemble, ils ont à s’entraider et à veiller les uns sur les autres.
La dimension spirituelle
La vie spirituelle est le premier devoir du prêtre pour rester intimement attaché à Celui qui l’a envoyé et pour servir cette rencontre des hommes avec le Christ. Le prêtre ayant la mission d’annoncer l’Évangile, il convient qu’il reçoive avant tout cette Parole pour lui-même, par une fréquentation vivante et partagée de l’Écriture. Il puise dans l’Eucharistie quotidienne la charité pastorale qui lui permet de se donner à ceux qui lui sont confiés. Il développe ainsi une amitié toujours plus profonde avec le Christ. Elle se renforce dans l’exercice du ministère.
Au jour de son ordination diaconale, le futur prêtre s’engage à célébrer quotidiennement la liturgie des heures, en communion avec toute l’Église, pour rendre gloire à Dieu au nom de l’humanité et intercéder pour l’Église et le monde.
L’oraison, les temps de retraite, l’accompagnement spirituel, la prière mariale, sont autant d’aides pour conserver et nourrir une intimité avec le Seigneur, pour garder l’élan missionnaire, pour traverser la fatigue ou les épreuves. Face aux nombreuses sollicitations de notre temps, cela représente souvent un combat mais c’est aussi un roc sur lequel s’appuyer, et une source de paix et de joie.
Des temps de relecture sont aussi nécessaires pour mieux répondre et pour s’ajuster aux appels du Seigneur qui évoluent au fil du temps, au cœur d’une même vocation.
La dimension fraternelle et relationnelle
La fraternité est à vivre avec l’ensemble des baptisés. Elle permet de se soutenir mutuellement dans la diversité des vocations et de s’encourager dans la marche à la suite du Christ.
Du fait de leur ordination, les prêtres sont unis par une fraternité sacramentelle (PO 8). Autant que possible, il est bon qu’ils puissent vivre en proximité, tout en disposant d’une légitime autonomie. Le lien avec une famille spirituelle ou la participation à une ‘‘équipe de vie’’ sont des soutiens précieux.
De justes relations familiales ou amicales contribuent aussi à cet équilibre et favorisent une ouverture au monde.
Lorsque surviennent la maladie, les épreuves, ou que la vieillesse s’installe, il est important que le prêtre ne se retrouve pas seul et qu’il puisse bénéficier d’un soutien plus spécifique de ses frères, mais aussi du Service d’accompagnement social des prêtres.
La formation et l’ouverture au monde
Pour accomplir son ministère, le prêtre doit toujours grandir dans la connaissance de Dieu et comprendre davantage le monde contemporain dans lequel il est envoyé. Ne pouvant se contenter de sa formation initiale, animé par une authentique quête intellectuelle et spirituelle, il veille à sa formation continue. Il participe notamment aux formations proposées dans le diocèse. D’autres formations à l’extérieur peuvent être complémentaires.
Le prêtre est ouvert aux réalités sociales et culturelles, non seulement selon ses goûts, mais aussi selon les besoins de son ministère, pour pouvoir comprendre et rejoindre ceux auprès desquels il est envoyé. De nombreuses possibilités lui sont offertes, à travers la rencontre des personnes, les médias, les livres, l’art, les voyages…
À la suite du Christ, vivre une sobriété évangélique
« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux. » (Mt 5, 3)
Le Pape François précise le sens de la pauvreté évangélique pour les prêtres. Elle est « la base de tout ministère. Un prêtre qui est pauvre dans le sens évangélique est un homme libre, libre de l’idolâtrie de la mondanité, de l’argent, de la vanité et de l’orgueil. Il doit être un homme qui sait que son trésor est ailleurs, et que c’est à ce trésor qu’il se consacre. » (Homélie de la messe chrismale 2016)
À l’ordination, le prêtre s’engage à servir toute sa vie l’Église et sa mission. En retour, son diocèse ou sa congrégation s’engagent également à subvenir à ses besoins, jusqu’à la fin de ses jours. L’ouvrier méritant son salaire, le prêtre reçoit ce dont il a besoin pour accomplir son ministère et mener une vie digne et sobre. En aucun cas le ministère ne doit être l’occasion d’un enrichissement personnel ou familial.
Voir Annexe : Conditions de vie matérielle des prêtres
Chapitre 5 – Vers le ministère de prêtre

Dimension vocationnelle de l’Église
Parler de vocation, c’est d’abord reconnaître que c’est Dieu lui-même qui a l’initiative, qui va à la rencontre de l’humanité et qui l’appelle à vivre dans son amour. Église signifie « assemblée », elle réunit ceux qui sont « convoqués ». En ce sens, toute l’Église a une dimension vocationnelle, car tous sont appelés à la sainteté et à contribuer à la mission, dans la diversité et la complémentarité des talents et des charismes. Saint Paul compare l’Église à un corps, en soulignant la spécificité et l’importance de chaque membre, ainsi que leur complémentarité. « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. » (1 Co 12, 4-7) Cette diversité est un don de Dieu pour son Église et pour le monde.
Dans l’Évangile, nous voyons que certains reçoivent un appel particulier à partager la mission de salut du Christ : « En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d’Apôtres. » (Lc 6, 12-13) Face à l’appel du Christ, chacun est invité à répondre librement : « L’histoire de toute vocation sacerdotale, comme d’ailleurs de toute vocation chrétienne, est l’histoire d’un ineffable dialogue entre Dieu et l’homme, entre l’amour de Dieu qui appelle et la liberté de l’homme qui, dans l’amour, répond à Dieu. Ces deux aspects indissociables de la vocation, le don gratuit de Dieu et la liberté responsable de l’homme, ressortent de manière très claire et particulièrement puissante dans les paroles lapidaires par lesquelles l’évangéliste Marc présente la vocation des Douze : Jésus « gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu’il voulait. Ils vinrent à lui. » (3, 13) (Jean-Paul II, Pastores Dabo Vobis 36)
Il est donc essentiel que la pastorale des enfants et des jeunes comporte un éveil vocationnel, c’est-à-dire une formation spirituelle pour développer leur relation personnelle avec le Christ et les aider à se rendre ainsi disponibles à son appel, qui s’exprime à travers un désir intérieur. Pour lui répondre et envisager d’engager toute sa vie, il faut aussi avoir une expérience concrète de la joie du service et du don de soi aux autres, dans le monde et dans l’Église.
Discernement initial
Si un jeune, ou un moins jeune, s’interroge sur une vocation de prêtre, il est important qu’il soit accompagné pour approfondir l’appel qu’il porte, développer une disponibilité confiante et généreuse. Avec son accompagnateur, il est invité à s’interroger : « Dieu m’appelle-t-il à me mettre au service de la mission de l’Église comme prêtre ? En ai-je un profond désir ? » Il est aussi invité à s’engager dans la vie de l’Église, dans un service pour la mission, selon ses possibilités.
Des temps forts peuvent jalonner ce chemin de discernement initial : pèlerinage ou JMJ, retraite spirituelle, session de discernement… Un accompagnement en équipe peut aussi être envisagé si plusieurs jeunes se posent la question de la vocation sacerdotale.
Un tel discernement s’accomplit dans la durée, pour une croissance humaine et spirituelle. La cohérence de vie et la persévérance dans son projet, un désir qui grandit, qui se fait plus fort et plus concret, témoignent de la réalité d’un appel. Quand le moment est venu, le jeune rencontre le responsable des séminaristes du diocèse ou l’Évêque.
Critères en vue d’un ministère presbytéral
Pour s’engager dans un temps de discernement et de formation en vue du sacerdoce, il faut être âgé d’au moins 18 ans et habituellement avoir déjà accompli un temps d’études supérieures ou de vie professionnelle. Baptisé et confirmé, membre de l’Église catholique, celui qui envisage un chemin vers le ministère presbytéral est ancré dans une vie de prière. Il se nourrit de la Parole de Dieu et des sacrements, il est engagé dans la vie de l’Église depuis un certain temps. Il a une cohérence de vie et un bon équilibre humain et affectif. Habité par le désir d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, il aime l’Église et porte le désir de se consacrer tout entier à sa mission de salut, dans le célibat. Il veut annoncer la Parole de Dieu et célébrer les sacrements, tout spécialement l’Eucharistie.
Le contenu de la formation
Le but de la formation est de permettre à l’intéressé de grandir dans son attachement au Christ, d’approfondir sa foi, de poursuivre le discernement de sa vocation et d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du ministère sacerdotal. Chacun est accueilli tel qu’il est, avec son histoire, son expérience humaine et chrétienne, et un cheminement adapté lui est proposé. Il comporte une formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale.
La formation humaine permet de développer une qualité de relation aux autres, avec tout ce que cela comporte d’ouverture, d’écoute, de générosité, de discernement, de compassion, d’humilité, de liberté, de fidélité… Cela suppose de prendre le temps de se connaître, de travailler son équilibre humain et affectif dans ses relations actuelles, d’ajuster ce qui doit l’être, pour aimer et se donner à la manière du Christ.
La formation spirituelle permet de développer une relation personnelle à Jésus-Christ, fondée sur la Parole de Dieu, l’Eucharistie et les sacrements, la liturgie des heures, l’expérience de la croix, la prière mariale, et fortifiée par une spiritualité qui la nourrisse. Il s’agit d’approfondir sa vie de prière et de développer une attitude filiale à l’égard du Père, une proximité avec le Christ, une disponibilité à l’Esprit Saint, de louange et d’intercession pour l’Église et pour le monde, en partageant l’amour du Christ qui s’est livré pour le salut de tous.
La formation intellectuelle permet de développer l’intelligence de la foi du candidat au sacerdoce, afin qu’il soit capable de rendre compte de l’espérance qui l’habite (cf 1 Pi 3, 15) et de savoir dialoguer avec le monde. Cela suppose une soif de vérité, une disponibilité intérieure au Christ qui se révèle et à l’Église qui le fait connaître. Cette formation comporte l’étude de la Parole de Dieu, des Pères de l’Église, des grands théologiens et du Magistère, pour approfondir les mystères de la foi, les grandes questions humaines et l’agir chrétien.
La formation pastorale plus spécifique pour le ministère arrive dans un second temps, lorsque la perspective de l’ordination se rapproche. Des formations au séminaire, des expériences pastorales pendant les vacances ou des temps de stage permettent de se préparer concrètement au ministère et de développer des liens avec le diocèse.
Étapes vers l’ordination
Le cheminement vers le sacerdoce se fait par étapes. Chaque pas est important. La première étape est l’année de propédeutique, un temps à l’écart pour fonder sa vie sur le Christ et discerner sa vocation. Le premier cycle prolonge ce discernement initial et apporte les fondements d’une formation humaine, spirituelle et doctrinale. Le second cycle prépare plus directement au ministère du prêtre et c’est ainsi que se forge progressivement un cœur de pasteur.
Tout au long de ce cheminement, des étapes institutionnelles sont marquées par un rite liturgique : l’admission parmi les candidats au ministère, l’institution aux ministères de lecteur et d’acolyte, puis l’ordination diaconale, et enfin l’ordination sacerdotale.
Conclusion
« Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. » (Jer 3, 15) Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour la grande diversité de prêtres donnés à notre Église diocésaine : diversité de générations, de charismes, de cultures, d’approches pastorales… La générosité et la foi des prêtres font la richesse de notre presbyterium. Puissent-ils réaliser, par leur ministère et par leur vie, la prière du Christ au seuil de sa Pâque : « Père, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. » (Jn 17, 4)
Prions donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson (Mt 9, 38) !
Père infiniment bon, Maître de la moisson,
donne à ton Église les pasteurs, les consacrés,
les missionnaires dont notre monde a besoin.
Que chaque jeune découvre la beauté de sa vocation
et y réponde avec confiance et générosité.
Qu’ensemble, nous nous mettions davantage
à ton service et à celui de tous nos frères.
Notre-Dame du Oui, prie pour nous !
Saint-Étienne, le 17 avril
Jeudi Saint de l’Année sainte 2025
+ Sylvain Bataille
Évêque de Saint-Étienne